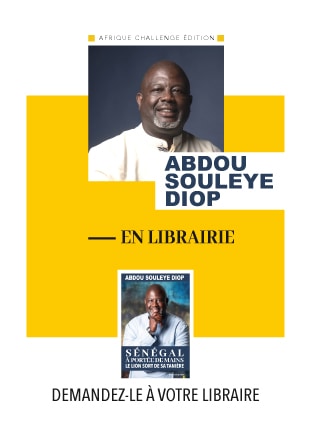Amadou Diaw, président fondateur du Groupe ISM, est une personnalité qui n’est plus à présenter. Le groupe ISM qu’il a fondé en 1992, labellisé Centre d’Excellence par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en 2005, occupe les premières places dans de grands classements des Business Schools en Afrique. Dans cette grande interview, il nous dresse le bilan de ces 25 ans d’existence, livre les secrets de cette réussite, aborde différents sujets tels que l’employabilité, la Recherche & Développement (R&D) et la dimension panafricaine de son groupe, et nous révèle ces futurs projets, en particulier le prochain Forum de Saint-Louis…
En 1992, vous avez décidé de créer l’Institut supérieur de management (ISM), le premier établissement dédié à l’enseignement supérieur privé au Sénégal. Qu’est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans ce challenge ?
Il faut se remettre dans le contexte. Nous sommes à la fin des années 80. Les angoisses des jeunes d’Afrique apparaissent. Les pays vivent les ajustements structurels dictés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). La Libéralisation des économies qui sera suivie de la dévaluation. Les Gouvernants tentent quelques initiatives en finançant des projets pour jeunes diplômés, les Programmes «Maitrisards». Cascade d‘échecs. Les croissances démographiques se confirment. Les diplômés des universités publiques sont plus nombreux. Cette tendance va d’ailleurs s’accélérer un peu plus tard. Les emplois se font rares. Les universités sont véritablement en crise. Un secteur privé africain nouveau tente de s’affirmer. Il s’organise. Ainsi naissent le CNP et la CNES (ndlr, Confédération nationale des employeurs du Sénégal). C’est dans ce contexte que je rentre en Afrique, après des formations acquises en Europe, pour ma part. Plusieurs de mes camarades reviennent du Canada ou des États-Unis. Bien entendu, la fougue de notre âge nous anime. Et c’est dans ce contexte qu’en relation avec le monde de l’entreprise, avec les Chambres de commerce, les organisations patronales, etc., que je fais le saut. Oui, je lâche tout pour réaliser mon projet : La Grande Université privée d’Afrique de l’Ouest. Donc l’écosystème est animé surtout par des professions libérales, experts-comptables, notaires, avocats et fiscalistes. Tous s’engagent à mes côtés.
Ainsi démarre l’aventure ISM, et en vérité celle des Business Schools en Afrique francophone. Dans mon esprit, les professionnels devaient prendre en charge les études des meilleurs étudiants. Une fois la machine lancée, il n’y avait quasiment plus personne. Les promesses… envolées. Mais le Business Model initial change vite. Je dois énormément aux sept amis sur les cinquante attendus qui ont été les premiers donateurs au profit de la Fondation mise en place. J’avais pensé RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise), trop tôt. Donc ainsi, l’ISM est devenu une entreprise au sens classique. Mais grâce à ces sept donateurs, aujourd’hui plus de 2.000 Africains ont bénéficié de formations gratuites pour une valeur supérieure à 10 milliards de francs CFA. Ce qui fait de nous, certainement, le plus gros donateur privé dans le secteur de l’Éducation en Afrique francophone.
Autre chose intéressante, aujourd’hui chacun des pays de la sous-région ouest-africaine compte au moins 100 écoles et universités privées. Et dans un pays comme le Sénégal, 1 étudiant sur 3 est dans un système payant. Donc la relation aux études supérieures a totalement changé en 25 ans, suite à notre modeste initiative.
Aujourd’hui, ISM compte environ 30 nationalités dans ses effectifs. Pourquoi ce pari d’une école panafricaniste ?
Ma génération, née avec les indépendances, a admiré Cabral, Nkrumah, Nyerere, etc. Nous avons toujours pensé Afrique. Pour ma part, une fois en Europe, pour mes études supérieures, j’ai appris encore plus sur l’Afrique au contact des autres condisciples venus du Bénin, du Cameroun, du Burkina et même de plus loin. Certains venaient d’Éthiopie. Donc, nous avons tous été des panafricanistes. Mieux, avec des amis, en France, nous avions créé le Groupe Anti-Appartheid de Rouen (GAAR). Donc, oui, nous avons été piqués au panafricanisme assez tôt. Tout ceci pour dire que jamais je n’ai pensé créer une école sénégalaise, mais une école africaine. Notre part, notre contribution au développement a toujours été fléchée «Afrique et au-delà». Et puis, si nous, éducateurs, nous n’avons pas une démarche africaine, si nous ne diffusons pas ce message «Afrique» nous aurons tout faux. Ceci au moment où le monde entier a un œil sur la jeunesse africaine montante. C’est cette jeunesse africaine qui bouge d’une terre à une autre, c’est cette jeunesse qui va dessiner le continent, qui va définir les Devenirs du monde.
En dehors de l’enseignement supérieur, votre groupe propose des formations dans le primaire et le secondaire au Sénégal. Quelles sont les raisons de ce choix ?
Après avoir diversifié nos programmes supérieurs (droit, management, sciences politiques, informatiques…), nous avons créé des Lycées d’excellence. Dès la première année, nous avons obtenu des résultats exceptionnels. Nous les avons maintenus à ce jour. On en parle peu. Mais c’est notre choix. Notre Lycée de Saint-Louis fait 100% à tous les examens alors que la moyenne nationale au bac est de 40%. Pour ma part, par ces réalisations, je tenais à démontrer que les fondamentaux au Lycée étaient la rigueur, le sens des responsabilités et le respect. Ma règle des 3R. Rigueur dans les actions que nous menons tous les jours. Responsables dans nos actes. Respectueux vis-à-vis de nous-mêmes et de notre entourage. J’étais convaincu qu’il fallait diffuser ces valeurs parmi la jeunesse de mon pays, la jeunesse africaine. Ainsi sont nés les Lycées Birago Diop à Dakar, Aimé Césaire à Saint-Louis et Léon Damas à Louga. D’autres lycées ont suivi. Ils ont pour parrains les personnages qui ont fait l’histoire de notre continent, l’histoire du monde noir. Nous avons par la suite créé les Espaces élémentaires d’excellence. (EEE). Nous sommes sur 12 campus satellites au Sénégal. Notre mission : créer une belle école pour l’Afrique.
Les MOOC constituent une nouvelle tendance dans la formation en Afrique et dans le monde. Les avez-vous intégrés dans votre cursus de formation?
Les MOOC se sont imposés partout, sur tous les continents. Et pourtant, le dernier rempart, c’est le monde des écoles francophones en Afrique. Paradoxalement, c’est nous qui en avons le plus besoin. Ici, aucun parent ne peut imaginer son enfant, à la maison, connecté pour suivre son cours. Et pourtant, un jeune étudiant nous a confié avoir préparé son Bac en cachette, grâce aux MOOC. Imaginez le nombre de succès scolaires que nous pourrions enregistrer en diffusant ce type de formations. Le gouvernement sénégalais m’a associé au lancement d’une Université virtuelle au Sénégal (UVS). J’avais auparavant participé au lancement de l’African Virtual University qui sera confiée par la suite à mon aîné et frère Cheik Modibo Diarra. Aujourd’hui, le Sénégal a son UVS, autour d’Espaces numériques ouverts. Il s’agit de petits villages numériques où les auditeurs peuvent se retrouver. Bref, une formule intermédiaire qui répond au besoin de présentiel. Il persiste encore un grand besoin d’explications, de sensibilisation.
Qu’en est-il de l’employabilité de vos lauréats ?
Je vais peut-être vous surprendre. Mais ce n’est plus un sujet pour moi. L’Afrique a besoin d’entrepreneurs. Donc au sein de notre groupe, nous avons supprimé le mémoire de 3e année. En lieu et place, nous imposons une création d’entreprises. Ce qui porte le taux d’employabilité à 100%. Donc, le diplômé a le choix entre faire vivre son entreprise ou aller chercher un emploi salarié. Pensez-vous vraiment que les jeunes qui traversent la Méditerranée ont besoin d’être formés à l’entrepreneuriat. Oui, nous pouvons avoir une Afrique riche de ses entrepreneurs. Les jeunes Africains sont prêts. J’avoue que même les familles n’adhèrent pas toujours à notre démarche. Mais, elles comprendront un jour.
Quelle place occupe la R&D dans vos activités?
D’abord, il ne peut y avoir de véritable université sans une large place pour la recherche. À la surprise de tous les milieux universitaires, nous avons mis en place, en 2003, une École doctorale. Elle a accueilli près de 100 auditeurs. Pour cela, il nous a fallu aller chercher des enseignants en Asie, en Amérique ou en Europe, aux côtés des professeurs de Dakar ou de Saint-Louis. Et puis en management, il y a tant de sujets pour l’Afrique. Je suis convaincu que nous pouvons occuper les espaces de recherche, les colloques internationaux en y présentant les résultats de nos travaux en Afrique. Pour nous, le développement porte plus sur les innovations pédagogiques. Là aussi, nous avons besoin de faire un saut. Mon ami Fred Swanikker, fondateur de l’African Leadership Academy (ALA), fait un travail extraordinaire sur Johannesburg, Port-Louis et Kigali, en termes d’innovations pédagogiques. Il prépare les jeunes à l’autonomie. Patrcik Awuah, à Accra, fait de même dans le cadre de ASHESI. Dans ses méthodes, il met en avant l’éthique. Tous les universitaires gagneraient à faire un tour sur ces campus. Le modèle français qui nous sert de repère tente lui-même d’évoluer. Mais nos systèmes universitaires, eux, évoluent trop lentement. Aussi, vous comprenez que nos méthodes aient été critiquées avant d’être acceptées et copiées. Je demeure optimiste.
L’ISM occupe la première place dans de grands classements des Business Schools en Afrique. Récemment, il a été plébiscité meilleur établissement de management au Sénégal par le classement «Eduniversal». Quels sont les secrets de votre réussite?
Tout à fait, nous nous sommes hissés au sommet des rankings au Sénégal puis en Afrique. Souvent juste derrière les 2 principales écoles du Maroc ou d’Égypte. Mieux, pour certaines disciplines telles l’enseignement du Management par la qualité, nous avons été cités dans des classements mondiaux. C’est le fruit de combats. Nous nous sommes lancé des défis.
La certification ISO était quasiment inconnue dans le milieu universitaire en Afrique, mais aussi aux États-Unis. Certains grands professeurs américains riaient de nous lorsque je parlais de process ISO. Cette accréditation avait un sens fort dans le milieu des entreprises. Nous en avons fait une priorité. Nous avons fait le saut. Récemment, donc près de 15 ans après, nous avons reçu un courrier de la plus haute autorité d’accréditation aux États-Unis, invitant les Business Schools à aller vers des certifications ISO. Des pistes telles que celle que je viens de décrire, l’Afrique peut en ouvrir tous les jours.
Nous avons été à la conquête des équivalences du CAMES (ndlr, Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur). Nous ne pouvions imaginer que nous ouvrions une porte pour les écoles du Sénégal. C’était une première au Sénégal. Le titre de Centre d’Excellence de l’UEMOA a été une forme de consécration. Au niveau international, nous avons été admis dans les cercles des Grandes Business Schools, l’EFMD (l’European foundation for management development) en Europe, l’AACSB (Association to advance collegiate schools of business) aux États-Unis et l’AMBA (Association of Masters of Business Administration) en Grande-Bretagne. Oui, nous avons ouvert toutes les portes aux écoles africaines. C’était notre mission de pionniers.
Il y a de cela quelques mois, j’ai invité, dans mon bureau, une vingtaine de présidents d’Écoles et Universités d’Afrique. Une fois sur place, je leur ai dit que je souhaitais juste partager quelques-uns de mes secrets et astuces, pour se maintenir au top dans les Rankings. Le premier des secrets est d’être animé par ce besoin de partager ce que l’on pense savoir. Ensuite, l’humilité qui est à mon avis le socle de toutes les réussites vraies. L’humilité est l’arme des forts, et l’arrogance celle des faibles. Trop de dirigeants d’école perdent la tête. Enfin, la passion. Il faut aimer ce que l’on fait. Il faut aimer l’autre. L’Homme est juste exceptionnel. Il nous faut réapprendre le vivre ensemble. Il y a urgence à l’enseigner partout, sous tous les cieux.
Récemment, vous avez décidé d’octroyer la majorité du capital de votre groupe au tandem Galileo-Providence. Qu’est-ce qui a motivé un tel choix ? Comptez-vous vous désengager progressivement de la gestion de l’ISM?
Oui, nous avons fait appel à Galileo et à Providence. Après 25 ans d’existence, à mon avis, le Groupe ISM avait besoin d’un autre souffle et, mieux encore, d’un autre modèle de Leadership. Nous avions besoin d’améliorer notre organisation, de renforcer notre assise financière et de renforcer notre réseau international. Sous un autre angle, si le problème des successions d’entreprises est crucial, il l’est encore plus sur le continent africain. Il me fallait travailler à la pérennisation de mon Groupe.
De plus en plus, on constate l’engouement de fonds d’investissement pour l’enseignement supérieur en Afrique. Quelle en est votre appréciation?
Le Groupe que je dirige en a été le premier bénéficiaire au Sénégal. Oui, je confirme cet intérêt manifesté par les fonds et l’effectivité de leurs investissements. D’abord en Afrique du Nord, au Maroc et en Tunisie, un peu à l’Est du continent, au Kenya et depuis cette année au Sénégal. Je crois que cela confirme deux faits : l’Afrique est bien un centre d’intérêt pour les investisseurs, et la jeunesse africaine, son éducation et sa santé vont susciter des investissements importants et constituer des marchés attrayants.
Vous aviez lancé le projet «Madiba Institute» avec votre partenaire IAM. Où en êtes-vous?
L’idée est partie d’une conviction. Le Sénégal est un pays phare en termes d’enseignement du management en Afrique. Les deux principaux établissements, l’ISM et l’Institut Afrique Monde (IAM) comptent, à deux, plus de 10.000 apprenants. Donc un effectif supérieur à celui de plusieurs universités. Cette mutualisation des ressources permet au Sénégal de réaffirmer sa position de leader dans l’enseignement du Management et, certainement, de se retrouver dans la cour des grands. Les deux équipes se retrouvent sur certains espaces et échangent. Les deux fondateurs, Moustapha Guirassy et moi, échangeons régulièrement.
Selon certaines sources, vous prévoyez de lancer prochainement des instituts «Ubuntu» sur le continent. Peut-on connaitre les grands axes de ce futur projet?
Il s’agit de cadre d’échanges, de rapprochement entre l’Asie et l’Afrique. Il y a de cela 15 ans, nous avons opté au niveau du Groupe ISM pour une ouverture vers l’Asie. Nous avons introduit l’enseignement du japonais, puis du mandarin, plus récemment du hangul coréen et du bassa indonésien. Ma démarche a été articulée autour de deux axes : Doit-on subir les mouvements démographiques et économiques qui caractérisent la relation Afrique-Chine? Je réponds «non». Nous devons en être des acteurs et ne pas attendre. Plusieurs pays asiatiques ont réussi à mettre en œuvre des politiques de développement sans renier leurs valeurs. L’Afrique, à son tour, a besoin de penser ses modèles de développement, mais aussi de se présenter au monde asiatique. Je suis convaincu que nous avons beaucoup de pistes communes. Ainsi, Asie et Afrique peuvent aller ensemble au grand rendez-vous du donner et du recevoir, que l’on appelle mondialisation, sans passer par l’Europe ou l’Amérique.
En tant que président de la Confédération des grandes écoles du Sénégal, pensez-vous que Dakar pourrait devenir dans le long terme un hub de la formation supérieure en Afrique?
Mes collègues m’ont porté il y a plusieurs années à la tête de la Conférence des Grandes Écoles du Sénégal (CGE). Simultanément, j’ai été au niveau le plus élevé des principales instances qui dessinent l’enseignement du Management sur le continent et au-delà. Partout, j’ai réaffirmé le rôle historique du Sénégal dans le développement des systèmes éducatifs en Afrique de l’Ouest. Il faut rappeler que les écoles Blanchot et Ponty étaient au Sénégal. Les Lycées Faidherbe et Van Vo, ces creusets du savoir qui ont fait l’élite africaine, étaient au Sénégal. Les principales écoles confessionnelles (catholiques comme musulmanes) étaient au Sénégal. C’est de ce pays que tous les systèmes éducatifs sont partis.
Donc il ne s’agit pas de faire de Dakar le hub, mais de réaffirmer que Dakar est le hub. Il nous faut le réaffirmer. L’Université de Dakar est encore la première université francophone, l’enseignement privé sénégalais occupe le Top 10 des principaux Ranking. Il nous faut le clamer plus souvent. Et tous les acteurs doivent travailler dans ce sens. Ma voix seule ne peut porter. Trop souvent, j’ai l’impression d’être seul à y croire. Le Sénégal doit être conscient que c’est cela sa richesse. Un pays comme l’île Maurice a compris cela et travaille dans ce sens. Nous avons besoin de communiquer autrement autour de notre richesse, au Sénégal : le Savoir, les Hommes.
Vous prévoyez d’initier bientôt le «Forum de Saint-Louis». Peut-on avoir une idée sur cet évènement?
Le Forum de Saint-Louis est une initiative privée. Je suis convaincu qu’aux côtés des États et des Gouvernants, les privés du continent ont la responsabilité d’accompagner les politiques de développement nationales, mais aussi d’impulser des démarches au niveau continental. Notre continent a beaucoup à donner, beaucoup à présenter au rendez-vous du donner et du recevoir. Saint-Louis, ville métisse tant par sa population, son histoire et ses religions, me semble être l’espace idéal, le carrefour à partir duquel la créativité africaine (arts, réflexions, lettres, technologies) peut être exposée au monde. Ainsi tous les deux ans, cette ville tricentenaire aux multiples facettes accueillera des centaines de décideurs du monde entier. La première édition du forum de Saint-Louis se déroulera durant le dernier trimestre de l’année 2017.
Entretien réalisé par Elimane Sembène